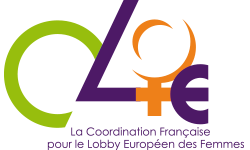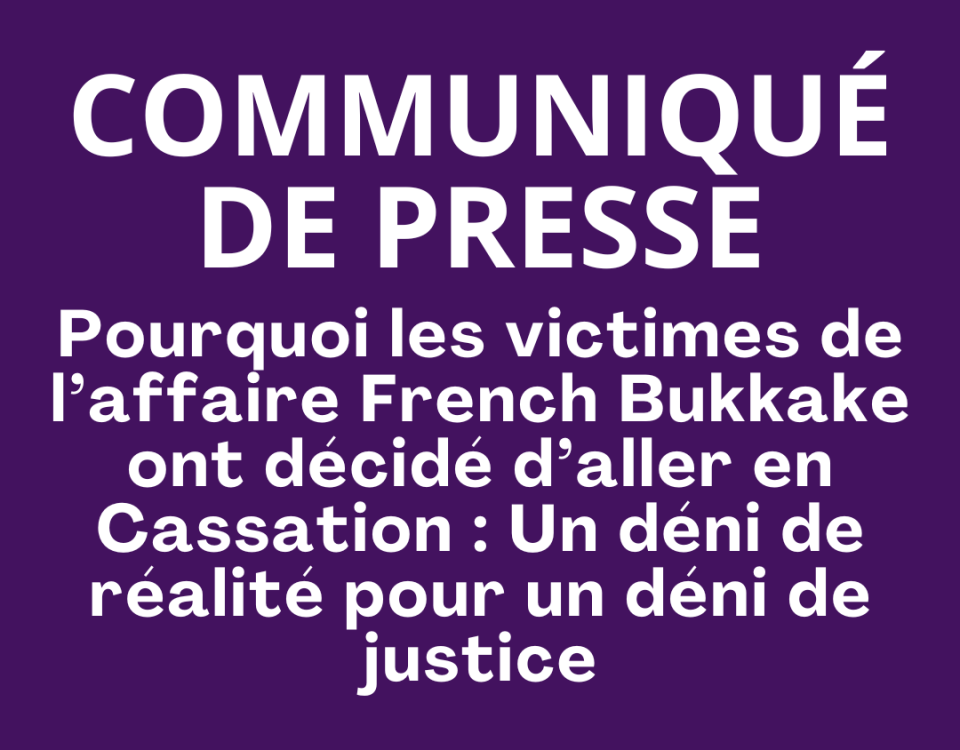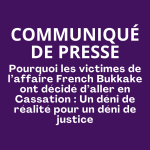
COMMUNIQUE DE PRESSE 23/04/2025 : Pourquoi les victimes de l’affaire French Bukkake ont décidé d’aller en Cassation : Un déni de réalité pour un déni de justice.
24 avril, 2025Revue de presse féministe & internationale du 21 au 25 avril
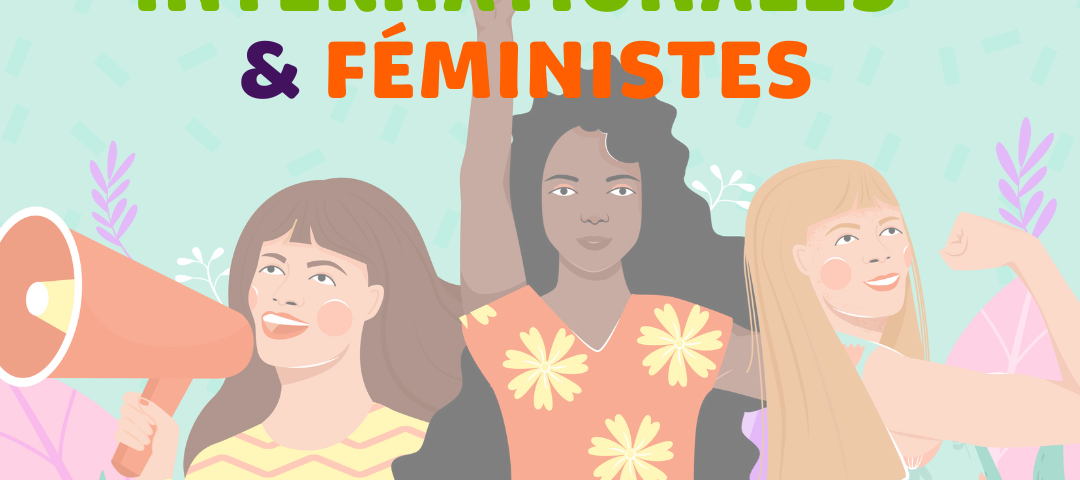
INTERNATIONAL
Le pape François et la place des femmes dans l’Église et en dehors : un bilan contrasté
Le pape François, décédé lundi 21 avril à l’âge de 88 ans, a marqué son pontificat de 12 années par des réformes significatives concernant la place des femmes, sans toutefois révolutionner la doctrine toujours marquée par une tradition conservatrice.
Le pape François a été à l’initiative d’avancées significatives, bien que timides, pour la place des femmes dans l’Eglise.
Lors d’une rencontre avec l’Union internationale des supérieures générales, en 2016, le souverain pontife avait loué “ le génie féminin “ et appelait “ à le laisser se manifester pleinement, au bénéfice de toute la société ”.Il a modifié le droit canon de façon à autoriser les femmes à assister les prêtres à l’autel et à distribuer l’eucharistie.
En janvier 2020, le pape François a nommé une femme laïque au poste de vice-présidente à la Secrétairerie d’État, un des plus importants ministères du Vatican, sorte de ministère des Affaires étrangères.
En février 2021, il nomme la religieuse française Nathalie Becquart sous-secrétaire du synode des évêques, l’équivalent de l’évêque (mais sans le titre). Elle se retrouve ainsi n° 2 d’une assemblée chargée de réfléchir et de débattre sur des sujets importants pour l’Eglise, en lui accordant en prime un droit de vote. D’ailleurs, en 2023, pour la première fois, des laïcs et trente-cinq femmes prendront part au vote des décisions de l’Assemblée.
Le 4 novembre 2021, la sœur franciscaine italienne Raffaella Petrini devient la femme la plus haut placée de l’Église catholique qui a comme fonctions la gestion des musées, de la poste et de la police du Vatican.
Le 13 juillet 2022, le pape nomme quatorze nouveaux membres du dicastère pour les Évêques, dont, pour la première fois, trois femmes. Parmi elles figure la religieuse française Yvonne Reungoat. Ces membres ont pour mission d’évaluer le profil des prêtres ou des évêques susceptibles d’être nommés à la tête d’un diocèse dont le siège est vacant.
Récemment, en 2025, il a aussi nommé l’italienne Simona Brambilla à la tête du » ministère » du Vatican chargé des ordres et des congrégations religieuses et Raffaella Petrini à la direction du gouvernorat du Vatican.
Toutefois, ces timides avancées n’ont pas de dimension transformatrice. En effet, les femmes catholiques fournissent la majorité du travail nécessaire au bon fonctionnement quotidien des Églises, et sont toujours invisibilisées, n’ayant le droit à aucun poste à responsabilité au sein des diocèses et paroisses.
Le sujet de l’ordination des femmes, pourtant assez présent dans les débats sur l’avenir de l’Eglise, reste clos. Dans un entretien accordé à la revue America Magazine, fin 2022, le pape affirmait qu’il n’était pas favorable à l’accession des femmes à la prêtrise.
Aussi, malgré son image de réformateur, le pape François a tenu en 2024 des propos qui ont choqué une partie de l’opinion publique, en particulier en ce qui concerne les droits des femmes et l’avortement, lors d’un déplacement en Belgique. Il affirmait que “ la femme est accueil fécond, soin, dévouement vital. La femme est donc plus importante que l’homme, mais c’est moche quand la femme veut faire l’homme, ça reste une femme “. Il qualifiait l’avortement comme un “ homicide ” et ajoutait que les médecins qui le pratiquaient étaient “ des tueurs à gages ”.
Alors que tout le monde parle de la succession du Pape François, mobilisant des personnalités de l’Eglise issues des quatre coins du monde dans un conclave, la question d’avoir une Papesse est tout simplement impossible dans l’organisation actuelle de l’institution catholique.
“La visite du pape François en Belgique avait laissé un sentiment de malaise”, RTBF, 21 avril 2025
De Filippis Abate, Violaine. “L’héritage trompeur du Pape François”, L’Humanité, 22 avril 2025
GAMBIE
Portrait du combat de Fatou Baldeh, nommée par le Time dans les 100 personnalités les plus influentes de l’année
Fatou Baldeh, docteure et chercheuse, est une militante gambienne classée parmi les 100 personnalités les plus influentes du monde par le « Time Magazine ». En 2024, elle a mené une campagne pour bloquer un projet de loi visant à légaliser les mutilations génitales féminines (MGF) en Gambie.
Fatou Baldeh est docteure et poursuit actuellement un doctorat à l’Université de Canterbury Christ Church au Royaume-Uni. Elle est également chercheuse au Medical Research Council Unit The Gambia à la London School of Hygiene and Tropical Medicine.
À la suite de ces études, Fatou Baldeh est retournée en Gambie et est devenue une fervante militante pour l’égalité entre les femmes et les hommes et pour la lutte contre la pratique de l’excision, pratique qu’elle a subi plus jeune. Appelées mutilations génitales féminines, elles consistent en l’ablation totale ou partielle des organes génitaux féminins extérieurs ou en toute autre lésion des organes génitaux féminins. Ainsi, elle a fondé l’organisation WILL “ Women in Liberation & Leadership ” dédiée à transformer et protéger la vie et les droits des femmes gambiennes.
En 2024, le parlement gambien a examiné un projet de loi visant à abroger l’interdiction des mutilations génitales féminines dans le pays, pourtant illégales depuis 2015. Au moment où le projet de loi a été présenté au Parlement, Fatou Baldeh accompagnées d’autres militantes, ont lancé une campagne pour bloquer le projet de loi. Grâce à son action et aux efforts collectifs des défenseuses, le projet de loi a finalement été rejeté en juillet de la même année. Dans ce contexte préoccupant, un retournement de situation inattendu a eu lieu mardi 15 avril : la Cour suprême gambienne s’est déclarée compétente pour examiner une plainte contre l’interdiction de l’excision, déposée par un député et plusieurs associations qui souhaitent sa dépénalisation.
Encore aujourd’hui et malgré son interdiction, la pratique, internationalement reconnue comme une violation des droits des filles et des femmes, reste un fléau de grande ampleur en Gambie : 73 % des femmes et des filles de 15 à 49 ans l’ont subi, selon les chiffres du Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef) pour 2024. Plus globalement, selon l’OMS, plus de 230 millions de filles et de femmes vivantes aujourd’hui ont subi des mutilations génitales féminines dans 30 pays d’Afrique, du Moyen-Orient et d’Asie où les excisions sont pratiquées.
Selon, l’UNICEF, certaines sociétés y voient un “ rite de passage” tandis que d’autres s’en servent pour réprimer la sexualité d’une fille. Aussi, dans les régions du monde où ces mutilations sont répandues, les familles les considèrent comme une condition préalable au mariage ou à l’héritage.
En conséquence, les mutilations génitales peuvent entraîner des risques immédiats (infections, choc traumatique, etc.), mais aussi des complications à long terme sur la santé physique, psychologique et sexuelle des femmes.
“Excision et mutilations génitales féminines”, UNICEF
“Gambian activist named among ‘Time’s 100 Most Influential People’”, The Point, 23 avril 2025
FRANCE
Le taux de prélèvement individualisé par défaut : une avancée pour l’autonomie économique des femmes
À compter du 1er septembre 2025, le taux de prélèvement à la source individualisé s’appliquera par défaut aux personnes marié·es ou pacsé·es. Cette mesure, prévue par la loi de finances 2024, vise à corriger une inégalité structurelle du système fiscal actuel qui pénalise en grande majorité les femmes dans les couples aux revenus déséquilibrés.
Jusqu’ici, c’était le taux commun du foyer qui s’imposait automatiquement. Mais ce système a souvent pour effet d’alourdir l’imposition de la personne aux revenus les plus faibles, tout en allégeant celle de la personne mieux rémunérée – souvent l’homme, dans 78 % des cas dans les couples hétérosexuels, selon l’Insee. Ce modèle fiscal conduit donc « à surtaxer le conjoint le moins fortuné (la femme dans la plupart des couples hétérosexuels) et à sous-taxer le plus fortuné (l’homme la plupart du temps) ».
« Aujourd’hui, dans plus de 80 % des cas, le taux d’imposition est le même pour les deux partenaires, alors qu’il y a parfois une grande différence de revenus, le plus souvent au détriment des femmes », a rappelé la ministre des Comptes publics Amélie de Montchalin.
L’individualisation du taux permettra désormais à chaque conjoint·e d’être imposé·e selon ses revenus personnels, ce qui constitue une avancée majeure pour l’autonomie financière des femmes, en particulier celles qui ne mettent pas tous leurs revenus en commun avec leur partenaire.
Toutefois, cette réforme n’est pas une solution miracle. Comme le souligne le journal Le Monde, « si cette mesure va dans le bon sens, elle ne règle pas tout, car le diable se cache dans les détails » :
- Elle ne s’appliquera qu’aux revenus professionnels. Les revenus locatifs ou financiers resteront soumis au taux commun, même lorsqu’ils appartiennent en propre à l’un·e des conjoint·es.
- La régularisation annuelle reste floue : aucune indication n’est donnée sur la manière de répartir un éventuel reste à payer ou remboursement.
Pour rappel, le taux individualisé existait déjà, mais sur demande. Or, faute d’information et parce que « l’option de l’un s’impose à l’autre », de nombreuses personnes n’y recouraient pas.
Ghana
Accusées de sorcellerie, des centaines de femmes exilées et abandonnées par l’État
Au Ghana, des centaines de femmes – souvent âgées, pauvres ou simplement indépendantes – sont accusées de sorcellerie et contraintes de fuir leurs villages, révèle un rapport d’Amnesty International publié le 14 avril 2025. L’ONG dénonce l’inaction persistante de l’État, qui laisse des femmes vivre dans des camps précaires sous l’autorité de chefs religieux, sans véritable perspective de retour.
Le rapport s’appuie sur près de deux ans d’enquête dans quatre de ces camps, où vivent des femmes victimes d’exclusion, souvent depuis plusieurs décennies. Les accusations, souvent lancées à la suite d’un décès ou même d’un rêve, visent presque toujours des femmes : âgées, veuves, malades ou encore économiquement autonomes. « Ce sont souvent des femmes de plus de 50 ans, vulnérables dans la communauté, ou des femmes qui réussissent bien dans la vie », explique Michèle Eken, chercheuse senior chez Amnesty International.
Les témoignages montrent que ces violences restent enracinées dans des dynamiques familiales et patriarcales. Fawza, une résidente d’un camp, raconte : « Mon voisin a dit qu’il avait rêvé que j’essayais de le tuer. Il ne veut pas de moi, c’est pourquoi il m’a accusée. ». Kukuo, une autre résidente, ajoute : « Ils s’arrangent toujours pour porter des accusations contre vous, surtout si vous travaillez dur, si vous restez forte et si vous vous débrouillez bien en tant que femme. »
Malgré l’adoption en 2023 d’un projet de loi visant à criminaliser les accusations de sorcellerie au Ghana, le texte n’a jamais été promulgué. Les associations appellent à une loi claire et à une réponse globale incluant des abris sécurisés, des programmes de réintégration sociale et des campagnes de sensibilisation.
Le rapport propose « l’adoption d’une approche holistique qui s’attaque aux causes profondes de ces abus, à travers des programmes de réintégration sociale et économique, ainsi que la protection et des réparations pour les personnes qui ont subi des abus à la suite d’accusations ».
FRANCE
80 ans du droit de vote des femmes
Le 29 avril 1945, pour la première fois en France, les femmes votaient. Cette date marque un tournant décisif dans l’histoire de la démocratie française : après un siècle d’exclusion politique, les Françaises devenaient enfin électrices, grâce à une ordonnance signée en 1944 par le général de Gaulle.
De 1848 à 1944, la République refusa obstinément ce droit, au nom d’arguments sexistes : supposée instabilité émotionnelle, influence néfaste de l’Église ou du mari, risque de désordre social… Ces thèses reléguant les femmes à un statut de citoyennes incomplètes, indignes de participer à la vie publique.
Ainsi, le 29 avril 1945, ce sont 12 millions de femmes de plus de 21 ans qui furent appelées aux urnes.
Les nombreuses images d’archives montrent des files d’attente devant les bureaux de vote, où se mêlent mères de famille, ouvrières, religieuses et jeunes femmes. Certaines, comme Gilberte Brossolette, décrivent ce moment comme celui où elles sont « enfin devenues des êtres humains à part entière ». Malgré le contexte difficile – rationnement, retour des prisonniers, reconstruction – 17 femmes sont élues ce jour-là, majoritairement sous l’étiquette du Parti communiste.
Cependant, comme le soulignent plusieurs historien·nes, cette conquête reste fragile. « Rien n’est jamais acquis », rappelle l’historienne Anne-Sarah Moalic. Ce droit, pourtant fondamental, ne fut jamais accordé à toutes les femmes en même temps, ni de la même manière. Dans de nombreux pays, il fut longtemps conditionné à des considérations ethniques et/ou sociales.La conquête du suffrage féminin s’inscrit donc dans une histoire d’exclusions multiples. Fêter les 80 ans du droit de vote des femmes, c’est aussi se rappeler que ce droit peut toujours être remis en question.