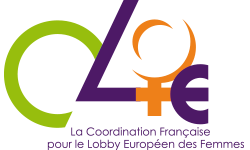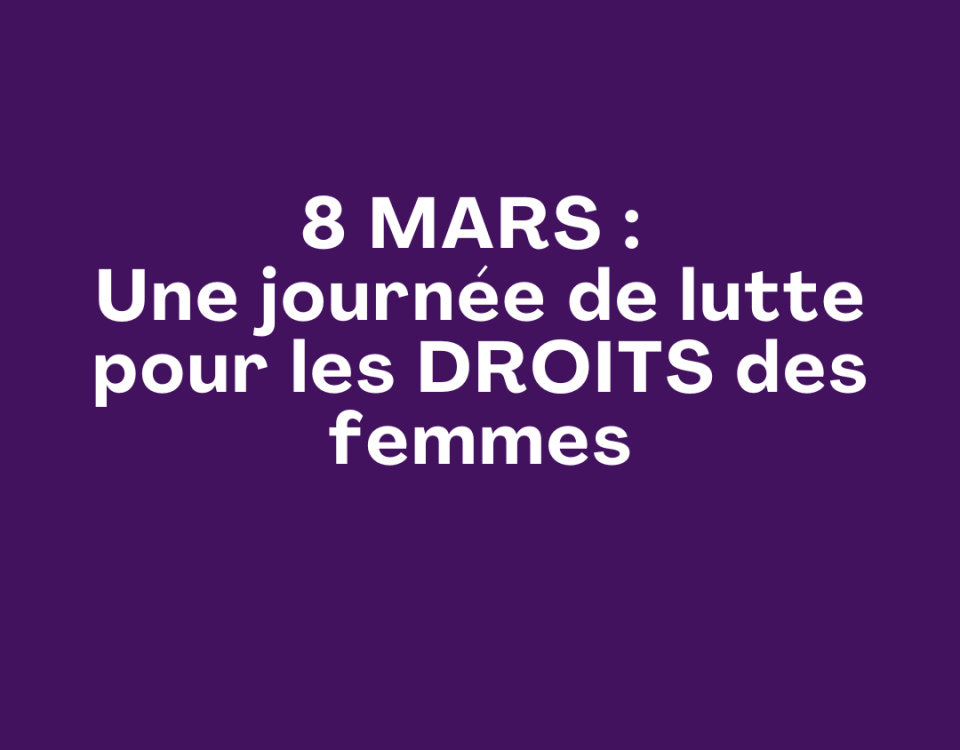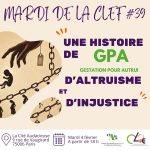
Mardi de la CLEF #39 : Une histoire de GPA, d’altruisme et d’injustice
27 janvier, 2025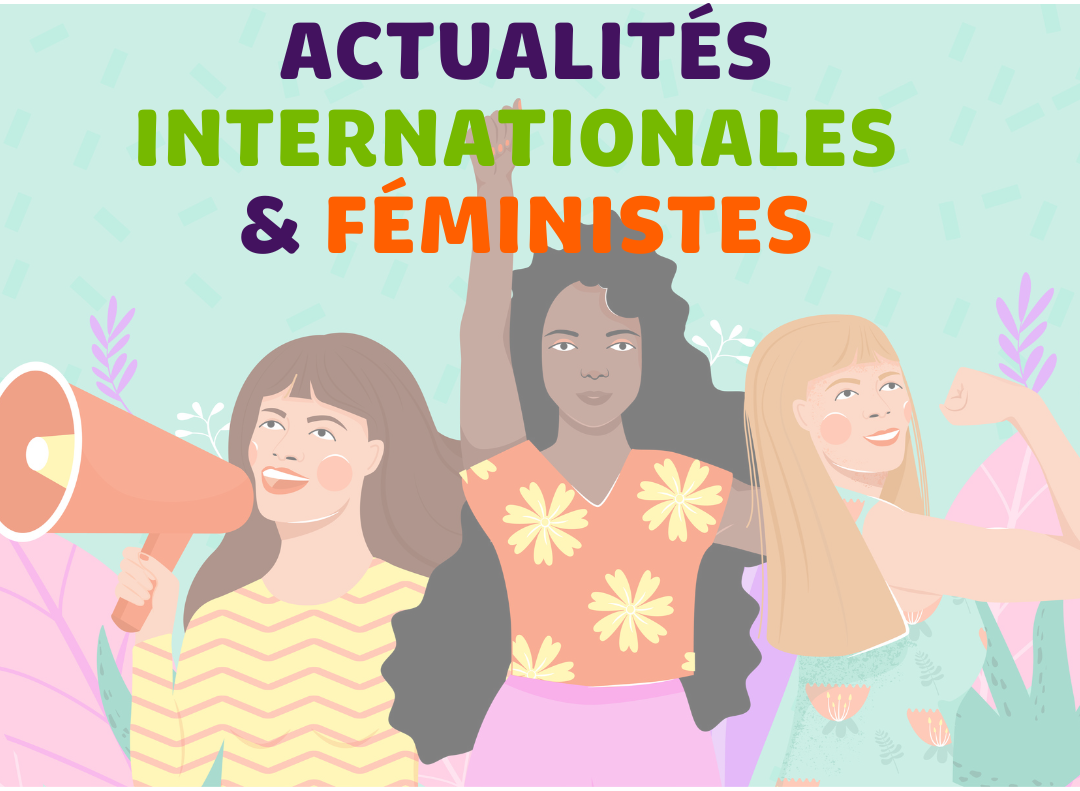
Revue de presse féministe & internationale du 3 au 7 février
7 février, 2025Revue de presse féministe & internationale du 27 au 31 janvier
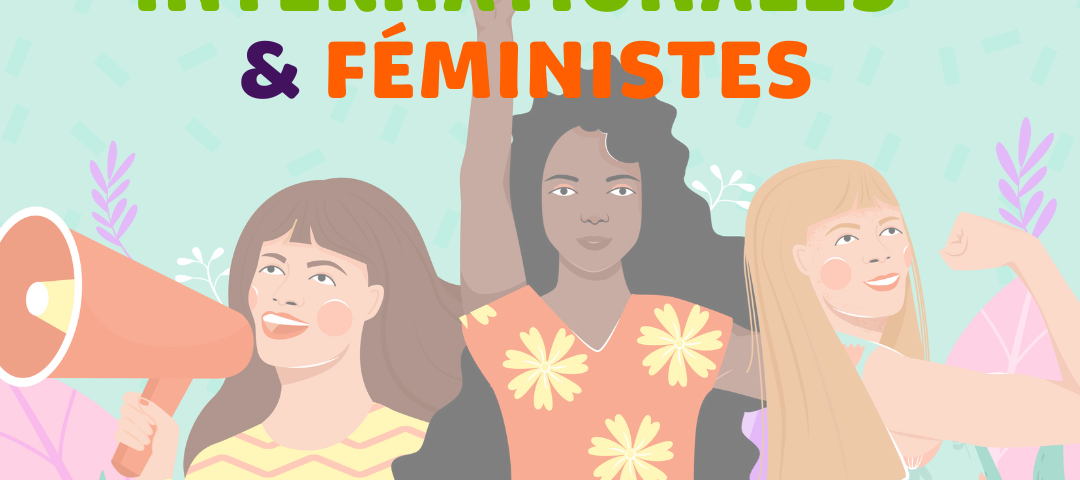
SIERRA LEONE
Un projet de loi sur la maternité sans risque
Le 17 décembre 2024, un projet de loi sur la maternité sans risque a été introduit au Parlement sierraléonais. Cette législation, actuellement en cours d’examen par une commission parlementaire spéciale, suscite des controverses.
« Cette loi offre aux femmes et aux jeunes filles des options sûres en matière de santé reproductive. […] Une mesure juste et attendue depuis très longtemps par les femmes et les filles de Sierra Leone » Tania Frazer, activiste féministe.
Approuvé par le Président, le projet de loi vise à garantir la santé et la dignité des femmes en âge de procréer. Dans un pays où le taux de mortalité maternelle figure parmi les plus élevés au monde, l’impact de cette législation pourrait être considérable. Selon les autorités sanitaires, environ 10 % des décès maternels sont liés à des avortements à risque. Chaque jour en Sierra Léone, jusqu’à quatre femmes ou filles meurent de complications liées à la grossesse et les avortements non médicalisés sont responsables d’environ 9 % des décès maternels. Les grossesses chez les adolescentes restent élevées, touchant un peu plus de 22 % des filles âgées de 15 à 19 ans, ce qui représente près de 10 % des naissances et la moitié des décès maternels dans le pays.
Le projet de loi vise à dépénaliser l’avortement, garantissant que toute fille ou femme, quelle que soit sa situation économique, puisse accéder à des soins de santé reproductive auprès de professionnel.les qualifiés. Il offrirait également des moyens pour lutter contre les grossesses non désirées en facilitant l’accès à la contraception.
Malgré l’avancée majeure que représente ce projet de loi, certains chefs religieux veulent le bloquer, jugeant qu’il va à l’encontre des fondements moraux du pays.
« C’est une pratique très libérale et contraire aux sensibilités des Sierraléonais donc nous nous y opposons. L’idée de légaliser cette loi ouvrirait la porte à toutes sortes d’interruptions de grossesses pour différentes raisons et certains termes du projet de loi sont ouverts à toutes sortes d’interprétations ». Evêque Edward Talbot Charles
Le conseil interreligieux de Sierra Leone fait pression pour que les député·es retirent ce projet de loi.
Les mouvements d’extrême droite anti-avortement s’appuient sur des arguments religieux fondamentalistes, inspirés des États-Unis, qui mettent en avant les « valeurs familiales ». Cela contribue à renforcer l’influence de la droite américaine, une dynamique qui ne fera que s’accentuer avec Trump au pouvoir. Avec des mesures comme la réintroduction de la Global Gag Rule, qui coupe le financement des ONG internationales promouvant l’avortement, ces idées se diffusent à l’échelle mondiale, renforçant encore l’influence de la droite américaine sous Trump.
« Les problèmes de santé des femmes ne devraient tout simplement pas faire l’objet d’un débat, et le projet de loi sur la maternité sans risque n’est pas seulement une réponse à une crise sanitaire, c’est un impératif politique et moral. » Docteure Ramatu Bangura, co-PDG de Purposeful.
https://www.youtube.com/watch?v=YTjdVoL4OvU
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20241229-sierra-leone-vives-tensions-l%C3%A9galisation-avortement
FRANCE
La France condamnée par la CEDH
Le jeudi 23 janvier, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a condamné la France pour avoir prononcé un divorce pour faute aux torts exclusifs d’une épouse ayant refusé des rapports sexuels avec son mari, en s’appuyant sur le manquement au « devoir conjugal », une notion jugée incompatible avec les droits conventionnels, notamment l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (droit à la vie privée et familiale), selon les juges européens.
Etat des lieux législatif français :
Le Devoir Conjugal : une invention prétorienne
Le « devoir conjugal » n’est pas inscrit dans la législation française. Historiquement, cette notion trouve son origine dans le droit canonique (ecclésiastique), où elle se rapportait davantage à une obligation de procréation entre époux et épouse qu’à une véritable obligation d’acte sexuel.
En revanche, le Code civil de 1804 ne traite pas explicitement des relations sexuelles entre époux et épouse. Les obligations conjugales sont définies au chapitre VI du Code civil, intitulé Des devoirs et droits respectifs entre époux (articles 212 à 226), qui énonce notamment :
- Article 212 : « Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. »
- Article 215 : « Les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie. »
S’ensuit, le titre VI du Code civil, consacré au divorce, qui comprend dans son chapitre I le divorce pour faute.
Selon l’article 242 : « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. »
Le juge, en tant qu’interprète de la loi, a progressivement développé une jurisprudence extensive des articles du Code civil relatifs aux obligations matrimoniales. C’est dans ce cadre qu’a émergé un devoir non explicitement reconnu par la loi : le devoir conjugal.
Une jurisprudence de principe datant du 17 décembre 1997 établit que « l’abstention prolongée de relations intimes imputées à l’épouse » pouvait justifier le prononcé du divorce pour faute, dès lors que cette abstention « n’était pas justifiée par des raisons médicales suffisantes ».
Cette position, profondément ancrée dans une vision archaïque et incompatible avec les principes de consentement et de liberté de disposer de son corps, a néanmoins continué à influencer les juridictions de première instance. (Cf : Arrêt de 2011 Cour d’appel de Aix-en-Provence)
Le paradoxe : la répression du viol conjugal
En dépit de cette jurisprudence, le viol entre époux est reconnu en France depuis une jurisprudence de 1990 et consolidé par un arrêt majeur de la Cour de cassation le 11 juin 1992. À l’échelle européenne, cette reconnaissance a été renforcée par l’arrêt S.W. et C.R. c. Royaume-Uni, qui établit véritablement l’idée selon laquelle le viol commis au sein du mariage est une atteinte grave aux droits fondamentaux, notamment aux droits conventionnels.
Forte de ces arrêts, la loi du 4 avril 2006, visant à prévenir et à réprimer les violences au sein du couple, a introduit l’article 222-22 du Code pénal, qui mentionne explicitement le viol conjugal comme relavant d’une infraction criminelle.
Toutefois, cette avancée juridique mettait en lumière une contradiction majeure dans la législation française. D’un côté, le droit réprime fermement le viol conjugal (constitutif d’un crime). De l’autre, il tolère encore la notion de « devoir conjugal », permettant de sanctionner le refus de relations sexuelles au sein du mariage. Cette ambiguïté juridique, mêlant liberté individuelle et obligation matrimoniale, aboutit à une incohérence profonde : punir un époux ou une épouse pour ne pas avoir “satisfait” les “attentes sexuelles” de l’autre tout en interdisant le viol conjugal et de ce fait, faire du mariage une exception au viol.
L’affaire H.W contre / France : l’extinction du devoir conjugal
Bref résumé des faits
Mme H.W. et M. J.C., étaient mariés et parents de quatre enfants.
- 2012 : Mme H.W. demande le divorce.
- 2015 : Elle sollicite un divorce pour faute, avançant la négligence de M. J.C. envers leur famille et un comportement violent.
- Demande reconventionnelle de M. J.C. : il demande le divorce aux torts exclusifs de son épouse, en invoquant : Son refus prolongé de relations intimes et des accusations calomnieuses, portant atteinte au devoir de respect mutuel.
Procédure interne
- Première instance (2018) : Le juge aux affaires familiales de Versailles refuse le divorce pour faute des deux parties, estimant que les accusations respectives n’étaient pas suffisamment étayées. Toutefois, il conclut que « les problèmes de santé de la requérante justifient l’absence durable de sexualité au sein du couple » et prononce un divorce pour altération définitive du lien conjugal.
- Appel (2019) : La cour d’appel de Versailles revoit la décision et prononce le divorce aux torts exclusifs de Mme H.W. en considérant que :
« Le refus continu de relations intimes avec son mari, qui ne pouvait être excusé par son état de santé, constituait une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune. » - Pourvoi en cassation (2020) : La Cour de cassation rejette le pourvoi de Mme H.W., jugeant que « les moyens invoqués n’étaient manifestement pas de nature à entraîner la cassation ».
Ayant épuisé toutes les voies de recours internes, Mme H.W., saisit la Cour européenne des droits de l’homme.
Procédure devant la CEDH
Le 5 mars 2021, Mme H.W. dépose une requête auprès de la CEDH, invoquant une violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (droit au respect de la vie privée et familiale). Elle conteste les motifs du divorce prononcés à ses torts exclusifs, qu’elle estime incompatibles avec ses droits fondamentaux, notamment en ce qui concerne le consentement et la liberté sexuelle.
La cour observe en premier lieu, que le divorce pour faute aux torts exclusifs de la requérante a été prononcé sur l’assise des articles 229 et 242 du code civil, mais surtout et c’est là tout l’enjeu, sur une jurisprudence trop longtemps établie.
« La Cour en conclut que les ingérences litigieuses reposaient sur une jurisprudence interne bien établie. »
Les juges européens examinent ensuite la légitimité du but poursuivi :
« la Cour reconnaît que la finalité des ingérences litigieuses, qui renvoient au droit de chacun des époux à mettre fin aux relations matrimoniales, se rattachait à la « protection des droits et libertés d’autrui » au sens de la Convention »
La CEDH s’est également interrogée sur la question de savoir si :
« les juridictions internes ont ménagé un juste équilibre entre les intérêts individuels concurrents en jeu. » (rôle principal de la Cour lorsqu’elle rend une décision)
Les juges européens rappellent à juste titre que, dans la mesure où les ingérences en cause touchent à l’un des aspects les plus intimes de la vie privée, la marge d’appréciation laissée aux États contractants (ici la France) en la matière, est étroite. Seules des raisons particulièrement graves peuvent justifier des ingérences des pouvoirs publics dans le domaine de la sexualité.
En outre, la notion de « devoir conjugal » en droit français ne prend pas en compte le consentement aux relations sexuelles, ce qui, selon la CEDH, « est contraire à la liberté sexuelle et au droit de disposer de son corps » et donc au droit conventionnel (issu de la Convention EDH).
Les associations féministes ont donc félicité le fait que la CEDH a affirmé que le consentement au mariage ne peut pas être interprété comme un consentement permanent aux relations sexuelles futures :
« Aux yeux de la Cour, le consentement au mariage ne saurait emporter un consentement aux relations sexuelles futures… Le consentement doit traduire la libre volonté d’avoir une relation sexuelle déterminée, au moment où elle intervient. »
La Cour rappelle bien heureusement à la France, que tout acte sexuel non consenti est constitutif d’une forme de violence sexuelle et souligne que l’existence même d’une telle obligation matrimoniale est contraire à l’obligation positive de prévention des violences sexuelles, dont est tenu la France et les Etats membres.
Les féministes saluent cette décision supranationale, qui met en lumière l’aspect archaïque et criminel qu’est le devoir conjugal, qui n’est qu’une façade pour couvrir les réalités du viol conjugal et des violences systémiques en général.
Bien que cette décision ait un caractère contraignant, en raison de l’obligation pour les États membres d’appliquer les arrêts de la CEDH dans leurs systèmes juridiques nationaux et d’adapter leurs législations en conséquence, on espère que le législateur français saura éradiquer le devoir conjugal de notre corpus législatif, rendant ainsi la jurisprudence de 1997 obsolète.
La société féministe demeure vigilante quant à l’évolution de cette obligation matrimoniale et continuera de dénoncer son hypocrisie, son caractère violent et son atteinte aux libertés individuelles.
https://hudoc.echr.coe.int/eng/#{%22itemid%22:[%22001-240199%22
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-62522%22
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417677/2006-04-05/
ESPAGNE
La police démantèle un réseau criminel et libère 9 femmes victimes d’exploitation sexuelle
La Police nationale espagnole a démantelé une organisation criminelle transnationale, laquelle exploitait sexuellement des femmes en situation de vulnérabilité à Alicante.
L’opération a permis l’arrestation de dix personnes, dont le dirigeant du réseau et son fils, ainsi que la libération de neuf victimes. Le fils du dirigeant était chargé de gérer les sociétés-écrans permettant de facturer les services sexuels, en plus de posséder l’une des propriétés où étaient exploitées les victimes. L’organisation, composée principalement de citoyens colombiens, avait élaboré une stratégie bien rodée pour recruter des femmes à l’étranger, organiser leur transfert vers l’Espagne et les exploiter sexuellement.
Les neuf femmes victimes étaient logées dans des conditions déplorables : pièces surpeuplées, sans lumière naturelle ni ventilation. Elles étaient surveillées en permanence à l’aide de caméras et contraintes à l’exploitation de leur corps. Dans l’un des appartements, un système de cloche relié à une télécommande était utilisé pour appeler les femmes à se présenter devant les clients qui pouvaient les « choisir » avant d’être servis.
Comme dans la majorité des cas de réseau d’exploitation sexuelle, certaines femmes étaient piégées par des dettes qu’elles « devaient » aux responsables du réseau ; une victime a témoigné avoir été endettée de 4000 euros.
Lors des perquisitions, la police a saisi des objets révélant l’ampleur des activités criminelles, dont une arme, beaucoup d’argent en liquide, des drogues et pilules, des chronomètres et de la documentation liée à la gestion financière du réseau. Plusieurs dataphones servant aux paiements ont également été récupérés.
Le démantèlement de ce réseau met en lumière l’ampleur des organisations de proxénétisme et de la traite des femmes.
L’Espagne demeure un pays à haut risque pour la traite des êtres humains, d’après le rapport GRETA 2023 RAPPORT D’ÉVALUATION ESPAGNE (groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains) du Conseil de l’Europe : « L’Espagne reste principalement un pays de destination et de transit pour les personnes soumises à la traite. »
Le rapport rend des données assez alarmantes sur la situation : (collectées par le Ministère de l’Intérieur Espagnol)
- De 2017 à 2022 : 1687 personnes ont été identifiées en tant que victimes de traite d’être humains.
- 60 % des victimes sont victimes d’exploitation sexuelle : Principale forme de la traite
- 90 % des victimes de cette traite sont des femmes.
Conscient de cette problématique, le gouvernement espagnol s’efforce de faire évoluer la situation malgré un progrès assez lent et difficile. Le GRETA a exhorté l’Espagne à intensifier ses efforts pour prévenir la traite à des fins d’exploitation sexuelles notamment, bien que l’adoption des plans nationaux de lutte contre la traite en 2021 marque un progrès, leur efficacité reste limitée en raison de l’absence de budget dédié.
Par ailleurs, l’Espagne s’est récemment fait condamner par la Cour Européenne des Droits de l’Homme, dans son arrêt du 10 octobre 2024 Affaire T.V. c. Espagne (requête n° 22512/21) , la CEDH a jugé que les lacunes significatives dans l’enquête des autorités espagnoles sur une plainte pour traite à des fins de prostitution représentaient une violation des obligations procédurales de l’Espagne en vertu de l’article 4 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Art 4 : (Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.)
Bien que cette arrestation démontre que les autorités espagnoles s’efforcent d’enquêter sur la traite des êtres humains, en particulier l’exploitation sexuelle, qui représente 60 % des cas, l’Espagne, comme de nombreux autres pays, doit tout de même intensifier ses actions pour mettre fin à cette exploitation inhumaine.
Ce phénomène revêt une forte dimension féministe, puisque 90 % des victimes sont des femmes et cette affaire témoigne une fois de plus de cette réalité. La vulnérabilité de nombreuses femmes, souvent en situation de précarité, d’endettement et contraintes à cette exploitation, exige une approche qui intègre pleinement la dimension genrée et intersectionnelle du problème. Cela est indispensable pour mettre en place des mesures adaptées aux situations complexes auxquelles ces victimes sont confrontées.
https://www.coe.int/fr/web/anti-human-trafficking/all-news
https://rm.coe.int/rapport-d-evaluation-du-greta-sur-l-espagne-greta-2023-10-3e-cycle-d-e/1680ab8d10