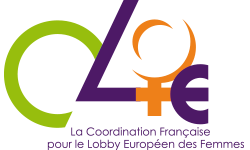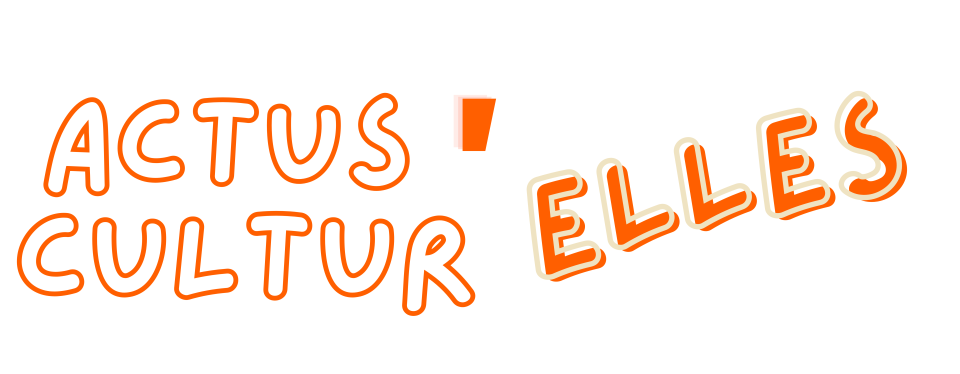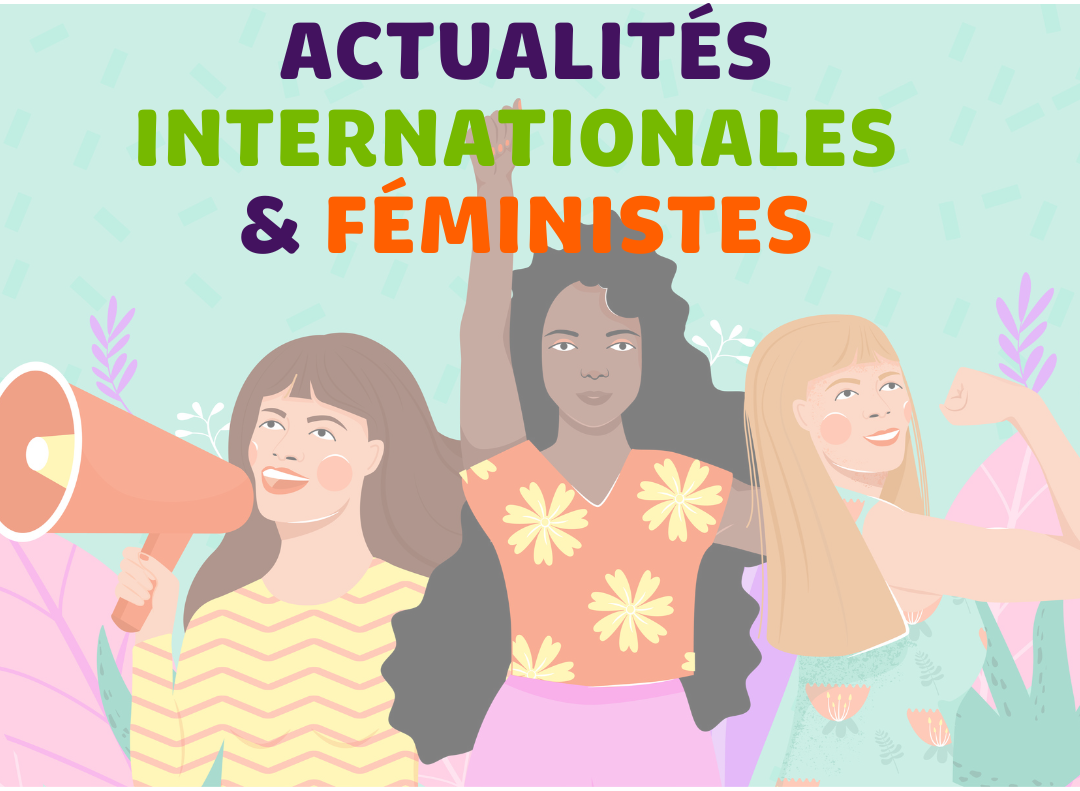
Revue de presse féministe & internationale du 13 au 20 octobre
20 octobre, 2023
COMMUNIQUÉ DE PRESSE – Pour un acte II de la CIIVISE
31 octobre, 2023Revue de presse féministe & internationale du 20 au 27 octobre

ISLANDE
« Vous appelez ça égalité ? »
Ce mardi 24 octobre 2023, les Islandaises n’ont pas travaillé de toute la journée pour la deuxième fois en cinquante ans. La première ministre a appelé toutes les femmes de l’île à participer à une mobilisation générale afin de dénoncer l’écart de salaire entre les hommes et les femmes à travail égal ainsi que les violences de genre.
Cette année, la « journée libre pour les femmes », Kvennafrí en islandais, s’est à nouveau déroulée sur toute une journée, durant laquelle les femmes étaient invitées à ne pas travailler mais également à ne réaliser aucune tâche domestique, un travail non rémunéré souvent attribué aux femmes. On observe alors les taux de féminisation de certains emplois et notamment dans les domaines du care. L’union islandaise des professeurs rapporte par exemple que 94% des enseignant·es de maternelle sont des femmes. De même, selon le Times que ce sont 80% de femmes qui constituent les équipes du plus grand hôpital de l’île. C’est pourquoi la grève a touché les écoles et les crèches, dont 59% ont été fermées dans la capitale, dans la mesure où ce secteur est composé à 75% de femmes. Ces métiers traditionnellement féminins restent dévalués et sous-payés, par rapport à des secteurs dominés par la gent masculine tels que la finance. Tous les autres lieux ont tourné au ralenti, principalement les hôpitaux où ne sont restées ouvertes que les urgences. Les femmes travaillant dans les hôpitaux, bien qu’elles n’aient pas pu se joindre à la grève, ont exprimé leur soutien total au mouvement. La première ministre elle-même a décidé de ne pas remplir ses fonctions en ce jour, décalant une réunion de cabinet au lendemain. Au total, entre 70 000 et 100 000 personnes (sur une population totale de 372 000 habitants) ont été recensées dans les manifestations aux quatre coins de l’île, dont la principale se trouvait à Rejkjavik.
Au vu d’une telle manifestation, il est difficile de croire que l’Islande est le premier pays au monde en termes d’égalité selon le Forum Économique Mondial. C’est également le premier pays à avoir élu une femme à la tête de l’Etat en 1980. Pourtant, les Islandais·es ne semblent pas satisfaites de ces simples statistiques, une des organisatrices de la mobilisation dira, à ce sujet, aux journalistes : « On parle de l’Islande comme si c’était un paradis de l’égalité. Mais un paradis de l’égalité ne devrait pas avoir un écart salarial de 21% et 40% des femmes victimes de violences sexistes ou sexuelles au cours de leur vie ». A noter que les 21% soulignés ici ne sont pas une moyenne selon les statistiques du pays, mais un pourcentage maximum, surtout présent dans les grandes entreprises, notamment en finance. En moyenne, selon l’OCDE, l’écart de salaire entre les hommes et les femmes est de 10%, ce qui représente une baisse de 30 points par rapport à l’écart lors de la première manifestation, en 1975. Cette année-là, 90% des Islandaises avaient arrêté de travailler pour manifester en faveur de leurs droits. Depuis, cette initiative a été reconduite cinq fois, mais les femmes ne s’arrêtaient de travailler qu’à l’heure à laquelle elles n’étaient plus payées, afin de symboliser matériellement leur manque de salaire. Aujourd’hui, les femmes se mobilisent également contre les violences de genre, aussi bien envers les femmes qu’envers les personnes non-binaires qui peuvent être discriminées sur leur lieu de travail, ne pas être en mesure de trouver un emploi simplement à cause de leur genre.
« La discrimination salariale systémique affecte toujours les femmes et les violences de genre sont une pandémie qui doit être éradiquée » – Une organisatrice appelant à la mobilisation.
L’un des slogans de la journée libre des femmes était « Vous appelez ça égalité ? », soutenant ainsi que le pays ne doit pas se reposer sur ses acquis et continuer à se battre pour atteindre la réelle égalité des sexes. Être les premiers ne sert à rien si on ne montre pas l’exemple pourrait-on dire. Il est en effet possible de se poser des questions sur l’état des autres pays du monde, bien plus en retard sur les questions d’égalité salariale, de travail sous-traité ou encore de discriminations de genre. Que font-ils ? Sommes-nous, en France, capables de suivre un tel exemple avec un gouvernement majoritairement masculin ?
RFI, « Islande: les femmes, dont la Première ministre, en grève pour dénoncer les inégalités salariales », 23 octobre 2023.
Novethic, « »Vous appelez cela l’égalité ? » : Grève générale des Islandaises ce 24 octobre », 24 octobre 2023.
Reuters, « Icelandic women, including PM, strike for 24 hours over inequality », 24 octobre 2023.
ISRAËL/PALESTINE
La demande des femmes pour la paix.
Depuis la reprise alarmante des attaques tantôt par le Hamas sur les civils Israéliens, tantôt par l’armée israélienne sur les civils de la bande de Gaza, la paix semble l’option la moins destructrice. Mais encore faut-il la vouloir pour pouvoir l’obtenir. En Israël, en Palestine, et partout à travers le monde, les femmes se mobilisent pour la paix.
Elle est d’abord relayée par la société civile. En effet, le collectif « les Guerrières de la paix » se mobilise grandement pour « la paix, la justice et l’égalité » au Moyen-Orient, conformément à ses statuts. Fondé en 2022 par la réalisatrice Hanna Assouline, il réunit des femmes israéliennes, palestiniennes, iraniennes, françaises etc… Le 18 octobre, ces dernières publiaient une tribune dans le Monde « j’ai choisi mon camp, je choisis la paix » appelant à un rassemblement à Paris, sans drapeau ni revendications politiques autres que la paix. Certain·nes élu·es étaient présent·es, comme la sénatrice Mélanie Vogel.
Le 4 octobre 2023, une grande marche avait eu lieu à Jérusalem et sur les rives de la mer Morte pour demander l’obtention de la paix. Nommée « Mother’s call », cette vague d’espoir réunissant Israéliennes et Palestiniennes semble très loin des atrocités commises contre les populations civiles depuis le 7 octobre. L’absurdité de l’utilisation de la violence est encore plus flagrante depuis que la présidente de l’association organisatrice Women Wage Peace, la militante israélienne Vivian Silver, est portée disparue.
Les femmes politiciennes haussent également le ton pour le respect des populations civiles. Amina J. Mohammed, vice secrétaire générale de l’ONU, a lancé un mouvement international sur les réseaux sociaux via le hashtag #Womenforpeace. Ce dernier a été relayé par d’autres politicien·nes du monde entier : Sima Bahous, directrice exécutive d’ONU Femmes, Katrin Jakobsdottir, première ministre d’Islande, Ellen Johnson Sirleaf, ancienne présidente du Libéria et lauréate du Prix Nobel de la paix… Ce mouvement appelle les voix dirigeantes à s’unir pour la paix et le respect du droit humanitaire en temps de conflit armé.
Quand viendra le temps des négociations, il est crucial que la voix des femmes soit prise en compte dans le processus de paix. Revendication féministe de longue date, comme le témoigne l’expression « ni la guerre qui nous détruit, ni la paix qui nous opprime », l’inclusion des femmes, qui sont victimes de violences sexo-spécifiques en temps de conflits, est nécessaire. Depuis la résolution 1325 du Conseil de sécurité, qui a mis en place l’agenda onusien « Femmes, Paix et Sécurité », l’ONU favorise leur participation des femmes à chaque étape de ce processus de paix. Leur présence à la table des négociations est synonyme d’une paix plus inclusive et plus durable.
Les Nouvelles News, « Les Guerrières de la Paix appellent au rassemblement », 19 octobre 2023.
TV5 Monde, « »Guerrières de la paix » : les femmes, une autre voix pour la paix au Proche-Orient », 26 octobre 2023.
BOLIVIE
Une affaire de viol d’enfant révèle l’omniprésence des violences sexuelles dans le pays.
Le défenseur des droits bolivien a condamné les intimidations que recevaient une petite fille de 10 ans, violée par le directeur de son école. Cette affaire témoigne de la prévalence de la violence sexuelle en Bolivie et du déni autour de ces crimes, dans une société patriarcale profondément ancrée dans une culture machiste.
Si cette affaire sordide suscite à la fois indignation et consternation, pour la violence des faits et l’âge de la victime, elle est aussi porteuse d’espoir. En effet, selon Mónica Bayá, de l’ONG Comunidad de Derechos Humanos Bolivia, « le système judiciaire a, dans ce cas, réagi de manière appropriée »; elle espère ainsi que cela enverra « un message retentissant aux autres victimes ». La victime de cette affaire est une petite fille, âgée de seulement 10 ans, qui a été victime d’un viol, suite auquel elle est tombée enceinte. L’auteur présumé, le directeur de l’école d’Uncía, est âgé de 39 ans. Selon les accusations, l’homme aurait violé l’élève au début du mois d’octobre, après plusieurs semaines de harcèlement, notamment sur les réseaux sociaux. La réaction de la justice s’est faite sans attendre : le prévenu a été inculpé de viol dans l’attente d’une enquête, et se trouve actuellement en détention. La procureure de l’État de Potosí, Roxana Choque, a précisé qu’elle avait demandé la « mesure la plus forte », à savoir la détention préventive de l’accusé. Le Defensoría del Pueblo, l’équivalent du Défenseur des droits en France, a également indiqué avoir réagi rapidement en procurant un soutien médical et psychologique à la victime et à sa mère. Selon un communiqué du 17 octobre, le défenseur a en effet expliqué que la famille avait reçu des pressions psychologiques suite à l’arrestation de l’auteur présumé.
Selon le défenseur, un groupe de personnes, composé notamment du comité exécutif de la Fédération Régionale des Travailleurs de l’Éducation urbaine d’Uncía, a organisé une marche en soutien au directeur d’école, accusé du viol. Des enseignants et des membres du personnel de l’école ont tenté d’empêcher son arrestation en s’attaquant à un poste de police. Des tentatives de pression, sur le procureur et le juge, pour qu’ils libèrent l’accusé, mais également sur la famille de la victime, que certain·es manifestant·es accusent d’avoir « provoqué » le viol, ont été relevées. Le Defensoría del Pueblo a demandé que ces actes ne restent pas impunis et a demandé une « enquête exhaustive et transparente pour identifier les responsables ». L’institution s’est aussi adressée au corps enseignant de l’école, en leur demandant de se concentrer sur la prévention des violences sexuelles, puisque leur comportement avait entraîné une revictimisation et la mise en danger de la victime. Enfin, dans un communiqué datant du 19 octobre, le Defensoría del Pueblo a dénoncé le procureur Juan Quiroga, qui s’occupait de l’affaire, pour avoir entravé l’action du défenseur et ne pas avoir respecté les droits de la victime.
Cette affaire est révélatrice du fléau des violences sexuelles en Bolivie. Selon l’organisation Equality Now, le pays présente le taux de violence sexuelle le plus élevé d’Amérique latine, et, paradoxalement, un des taux de signalement de ces crimes les plus faibles. Les principales victimes de violence sexuelle dans le pays sont les filles mineures : une fille sur trois subit des violences sexuelles avant ses 18 ans… Bien que le nombre de signalements ait fortement augmenté ces cinq dernières années (on estime désormais à 30 le nombre de victimes chaque jour), les cas restent encore sous-déclarés. Cela est notamment dû à la culture machiste prégnante dans la société bolivienne, qui stigmatise les victimes et les contraint au silence, voire à la culpabilité/responsabilité de leur propre agression.
The Guardian, « Threats against rape victim, 10, lay bare Bolivia’s culture of sexual violence« , 21 octobre 2023.
La Razón, « Una niña de 10 años queda embarazada tras ser vejada en Potosí« , 17 octobre 2023.
Defensoría del Pueblo, « Defensoría del Pueblo exhorta a la Fiscalía no obstruir el seguimiento al caso de niña de 10 años víctima de violación« , 19 octobre 2023.
ARMÉNIE
La crise des avortements sélectifs.
Alors que la Chine tend à diminuer la quantité d’avortements sélectifs qui ont lieu au sein du pays, l’Arménie ne se laisse pas distancer et devient le 2e pays avec le plus fort taux d’IVG en lien avec le sexe de l’enfant. En effet, on y retrouve un ratio de 114 naissances de garçons pour 100 naissances de filles.
En cause, la place des filles et des femmes dans la société : les jeunes filles sont considérées comme une perte aux yeux de leurs parents dans la mesure où elles vont partir du foyer familial lorsqu’elles seront mariées, perdront leur nom de famille et ne pourront pas aider leurs parents financièrement. Du moins c’est le cas dans les parties les plus rurales et pauvres du pays – comme c’est déjà le cas en Inde par exemple. Le choix de l’avortement n’est que très rarement pris par la mère elle-même, mais plutôt suite à des pressions sociales du mari ou de la belle-famille.
En effet, beaucoup d’hommes veulent un garçon pour perpétuer le nom de famille, ce qui ferait d’eux des vrais hommes. C’est pourquoi ils sont prêts à tout, allant jusqu’à risquer la santé de leur femme, pour qu’elle ne donne pas naissance à une fille. Une femme arménienne raconte à ce propos, à des journalistes de Libération, que lorsqu’elle a appris être enceinte d’une fille, elle ne souhaitait pas avorter. Pourtant sa belle-famille, avec laquelle elle cohabitait à ce moment, a pris un rendez-vous avec un médecin pour la faire avorter. Son mari, quant-à-lui, l’a poussée du haut des escaliers, afin de lui faire faire une fausse couche. Alors qu’elle avait perdu des dents et que sa tête était contre le sol, il lui dit qu’elle a le choix entre avorter et se faire renier par lui et sa famille, ce qui la laisserait seule, sans argent et avec un enfant à charge. Malgré tout, c’est cette deuxième option qu’elle choisit. Au moment de l’entretien cela fait sept ans qu’elle passe de logement temporaire en logement temporaire, incapable de trouver un emploi stable car elle n’a pas de logement mais ne pouvant trouver de logement sans emploi. Malgré tout, elle a avec elle sa fille et soutient qu’elle n’a jamais regretté la décision qu’elle a prise. Il arrive pourtant que les femmes acceptent les demandes d’avortement voire prennent les devants pour éviter à leur fille de subir le même sort qu’elles : en Arménie, 63,8% des femmes disent regretter ne pas être nées homme. Il y a donc de manière claire une disparité forte entre les hommes et les femmes une fois à l’âge adulte.
« Nous devons nous attaquer à l’origine du problème, la mentalité patriarcale et la pauvreté très répandue, et non à ses conséquences » – Centre de ressources pour les femmes en Arménie.
Les conséquences ici évoquées sont donc les avortements sélectifs en masse contre lesquels se battent les législateurs du pays, mettant ainsi un pansement sur une plaie grande ouverte. Pour essayer d’y remédier, paraît par exemple une loi en 2016 interdisant les avortements sélectifs, suivie d’une loi en 2017 obligeant les médecins à ne divulguer aux parents le sexe de l’enfant qu’après douze semaines de grossesse, soit le délai maximal pour un avortement légal en Arménie. Cette loi est toutefois controversée puisque certains groupes soutiennent que cela va simplement engendrer une recrudescence d’avortements clandestins, mettant en danger la santé de la femme. En outre, elle n’arrête pas les familles souhaitant avoir un garçon qui sont prêtes à soudoyer les médecins afin d’avoir cette information en avance puis effectuer l’avortement. Finalement, en 2021, il est rendu criminel de forcer une personne à subir un avortement en raison du sexe de l’enfant. Malheureusement, aux vues des chiffres, ces simples lois pansements n’ont pas raison de l’avortement sélectif en Arménie. Les filles sont toujours considérées comme une perte dans les régions conservatrices et plus pauvres. Toutefois cela prouve que ce n’est pas l’enfant le problème mais la société dans laquelle il naît. En 2019, une femme explique qu’elle a « eu deux filles, mais [qu’elle] voulai[t] un garçon. Alors [elle a] fait deux avortements de filles, puis un autre de jumelles. ». Elle ajoute que si son mari lui avait laissé le choix, elle aurait donné naissance à tous ces enfants sans exception.
L’une des solutions proposées par le gouvernement arménien serait alors de contrôler l’accès à l’avortement pour les femmes. En effet, il est utilisé comme principale méthode de contrôle des naissances dans la mesure où il est gratuit dans les hôpitaux et permet aux hommes de garder la main mise sur la procréation : la pilule est diabolisée, laissant la femme avoir le contrôle de son corps. Toutefois contrôler l’avortement pourrait engendrer bien d’autres problèmes comme le retrait d’une liberté supplémentaire aux femmes.
Finalement, avec les années, ces avortements sélectifs posent de plus en plus de problèmes puisque les hommes, nés en masse, ne parviennent pas à trouver de femme. Selon Courrier International, il y aurait d’ici la fin de la décennie, un déficit de près de 4,7 millions de femmes dans le monde. Déjà aujourd’hui, des Arméniens disent être en difficulté pour trouver une femme du fait du manque considérable de celles-ci, ce qui met donc en péril l’équilibre du pays. C’est notamment ce qui était arrivé en Chine durant les lois de l’enfant unique, où les familles préféraient avoir un garçon. Aujourd’hui l’avortement est bien plus durement contrôlé afin de rééquilibrer la nation et rajeunir la population. En Arménie certaines personnes, comme les prêtres, utilisent cet argument pour essayer de stopper les avortements sélectifs : moins il y aura de femmes, plus les hommes devront se trouver vers autre chose pour assouvir “leurs besoins sexuels”. Le déficit de femmes dans le pays serait-il un tremplin pour une effervescence de l’homosexualité en Arménie. Qu’est-ce qui serait le pire pour un Arménien ? Avoir une fille ou un fils homosexuel ?
Libération, « «Ma vie était merveilleuse jusqu’au jour où j’ai appris que j’attendais une fille» : en Arménie, le tabou de l’avortement sélectif », 15 octobre 2023.
Ouest France, « L’avortement sélectif de bébés filles reste ancré et tabou en Arménie », 28 mars 2019.
Sciences Avenir, « L’Arménie face à l’explosion des avortements sélectifs de filles », 10 janvier 2017.
Fariba Adelkhah, prisonnière scientifique.
L’anthropologue franco-iranienne, chercheuse à Sciences Po, est revenue en France après avoir été détenue plus de quatre ans en Iran. Elle se bat aujourd’hui pour la liberté académique.
Fariba Adelkhah est une spécialiste de l’anthropologie sociale et politique de l’Iran postrévolutionnaire. Ses premiers travaux se consacrent à l’étude du rôle des femmes islamiques dans la Révolution, comme le montre son premier ouvrage, La Révolution sous le voile. Femmes islamiques d’Iran. Ses ouvrages suivants étudient d’autres sujets, toujours liés à l’Iran, tels que la modernité ou les clercs chiites.
Chercheuse au CERI (Centre de recherches internationales), affilié à Sciences Po, depuis 1993, c’est dans cette même école que Fariba Adelkhah s’est adressée publiquement pour la première fois depuis son retour en France le 17 octobre. Elle était entourée de la communauté de chercheur·es et d’enseignant·es, d’élèves ainsi que de son comité de soutien, qui s’est mobilisé sans relâche ces quatre dernières années pour obtenir sa libération, en février 2023, puis son retour en France, en octobre.
Son comité de soutien, et la communauté universitaire plus généralement, la qualifie d’ailleurs de « prisonnière scientifique ». Elle a en effet été emprisonnée sur la base de ses travaux universitaires. Comme la chercheuse l’explique elle-même, les chercheur·ses qui travaillent sur des sujets plus sensibles, comme les LGBTQ+ ou l’islam, sont souvent accusé·es de « parti pris ». Sa recherche sur les femmes dans la Révolution islamique a ainsi été à l’origine d’accusations de parti pris, dès le début. Pourtant, elle avoue ne pas avoir été une « courageuse » de poursuivre ses travaux mais plutôt une « inconsciente qui ne pensait pas que la recherche était risquée ».
« La recherche est l’abreuvoir de la liberté, continuons à y boire » -Fariba Adelkhah.
Prisonnière scientifique, prisonnière poétique aussi à ses heures perdues (elle est l’autrice de plusieurs poèmes), Fariba Adelkhah n’a jamais cessé de se battre pour la liberté académique. Elle raconte le temps passé à écrire et essayer de faire comprendre à ses interlocuteurs en prison ce qu’est véritablement la recherche. En effet, elle avait été condamnée à sa peine de prison sous le motif d’ « atteinte à la sécurité nationale ». Pendant ses quatre années et quatre mois de privation de liberté, Fariba a continué de se battre au nom de ses principes : elle « n’avait pas de revendication, sinon la recherche ». De retour en France, la chercheuse appelle aussi à réclamer cette liberté académique, y compris dans nos cercles, car il ne faut pas que « les uns puissent définir ce que peut être le sens de la recherche pour les autres ».
Interrogée sur les conseils qu’elle souhaiterait donner à la jeunesse iranienne, elle répond que c’est au contraire à ces jeunes, plus courageux·ses et moins conservateur·ices, de lui en partager. Fariba insiste aussi sur le fait que les deux grands mouvements de révolution, à savoir le mouvement des 1 million de signatures et celui, plus actuel, de Femme Vie Liberté, ont en commun d’être lancés par des femmes. Elle témoigne d’ailleurs de la « joie énorme » qu’a procuré le mouvement Femme Vie Liberté aux femmes emprisonnées.
An Edible Family in a Mobile Home.
« Food – shopping for it, cooking it, serving it, consuming it – is a consistent feature in Baker’s work, which focuses on the seemingly mundane, everyday details of life »
« La nourriture – l’acheter, la préparer, la servir, la consommer – c’est un pan clef du travail de Baker qui se concentre sur les détails de la vie quotidienne en apparence triviaux » – John Daniels, 2007
Le 8 novembre 2023 ouvrira dans le musée Tate Britain de Londres, une exposition récompensant plus de cent femmes artistes qui ont permis l’évolution de l’art mais également l’évolution du droit des femmes grâce à leurs travaux engagés. Au sein de cette exposition Women in revolt ! Art and activism in the UK 1970-1990, une femme va particulièrement nous intéresser : Bobby Baker.
Née en 1950 dans le Kent, au Royaume Uni, elle fera de longues études en art et deviendra finalement artiste spécialisée dans l’utilisation de la nourriture pour exprimer ses idées. Elle se concentre sur les différences entre la vie professionnelle et la vie domestique des femmes qui doivent souvent coupler les deux, parfois au détriment de leur santé mentale. La santé mentale est par ailleurs un point auquel l’artiste accorde beaucoup d’importance : elle apprécie travailler sur la stigmatisation et la discrimination que les personnes atteintes de troubles mentaux subissent. Bobby Baker est donc une artiste féministe intersectionnelle qui s’intéresse à la vie quotidienne, à ses enjeux et aux problèmes mentaux que certaines personnes doivent supporter. Pour critiquer tous ces points de la société, elle est devenue une artiste polyvalente, puisqu’elle réalise des sculptures de différentes matières ainsi que des dessins ou des peintures.
Dans les jardins du Tate Britain, il sera alors possible de trouver une reproduction d’une de ses œuvres : An Edible Family in a Mobile Home. Cette œuvre, originellement créée en 1976, est, comme le nom l’indique, une famille composée de gâteaux vivant dans un mobile home. Le père, en gâteau aux fruits se trouve avachi sur son fauteuil dans le salon, le fils adolescent à base de biscuits et de meringue, dans la baignoire, dans une eau de gâteaux au chocolat tandis que la mère, qui elle, n’est pas en gâteau mais en mannequin de couture se trouve dans la cuisine afin de préparer les biscuits et fruits qui se trouveront dans les compartiments découpés dans son tronc et le thé qu’elle pourra servir grâce à sa tête en théière. Les murs du mobile home sont quant à eux recouverts de feuilles de journaux ainsi que de glaçage émanant une odeur de sucre qui embaume toute l’exposition. A l’époque, l’artiste avait confectionné l’entièreté de cette œuvre en un mois puis l’avait mise en place en une semaine.
Pour cette reproduction, quelques changements et améliorations ont été apportés à l’originale à commencer par le fait qu’une équipe d’artistes, décorateurs, pâtissiers l’aident à tout préparer. En effet, les gâteaux seront préparés par une pâtissière spécifique, les murs seront recouverts d’un nouveau type de glaçage plus moderne et l’espace sera plus accessible afin que tout le monde puisse venir voir la famille de gâteaux. Famille par ailleurs agrandie puisqu’elle compte aujourd’hui trois enfants, un fils, toujours dans la baignoire, une fille et un bébé, posé dans un berceau à côté du père dans son fauteuil. Tous sont construits avec le même biscuit et meringue auxquels sont ajoutés des goûts spécifiques. Dans le même esprit d’inclusivité, des alternatives vegan seront proposées. La mère distribuera toujours continuellement des gâteaux, fruits et sandwichs. Pendant ce temps, des étudiants d’universités d’art londonienne serviront le thé, comme le faisait Baker en 1976 et expliqueront l’œuvre, après avoir reçu une formation personnelle de la part de l’artiste. Finalement il sera possible d’y trouver des photos de l’exposition originale afin de lui rendre hommage.
Une fois les deux périodes d’exposition passées (du 8 novembre au 3 décembre et du 8 mars au 7 avril), le mobile home fera le tour de l’Angleterre avant de terminer chez Idle Women, une association d’artistes féministes, qui pourront conserver l’œuvre afin de la faire revivre aussi longtemps qu’elles le pourront.
Fad Magazine, « Tate Britain to present a restating of major feminist artwork, Bobby Baker’s ‘An Edible Family in a Mobile Home' », 19 octobre 2023.